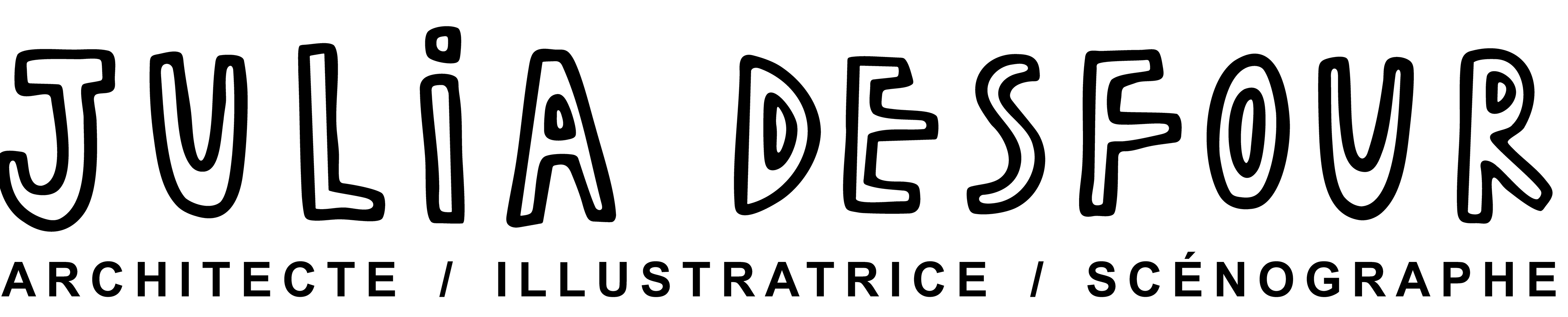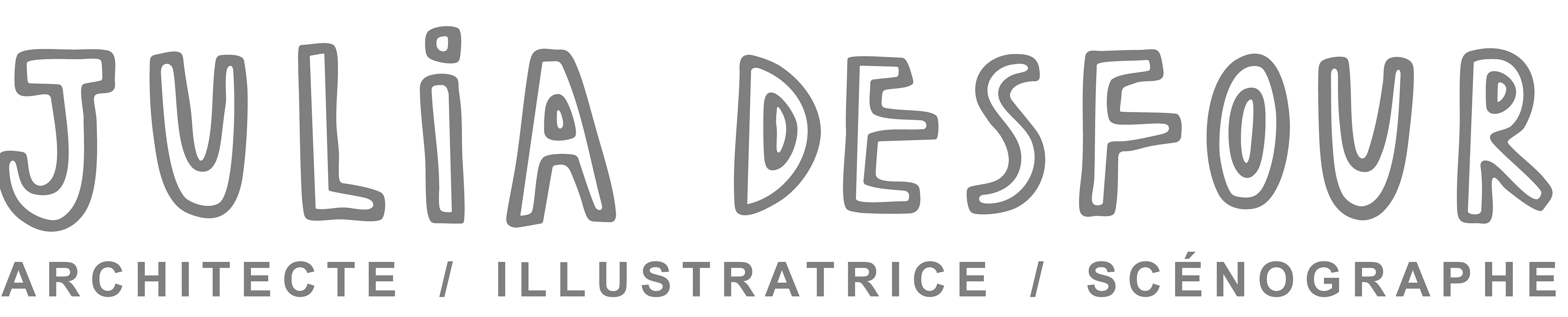Située aux portes de Paris, la cité Villette fonctionne en autarcie du reste de la ville. Cet ensemble de logements sur dalle classé au patrimoine culturel de Seine-Saint-Denis se trouve au carrefour de trois territoires importants: Aubervilliers, une des villes de l'EPT de Plaine Commune, Pantin se rattachant à l'EPT d'Est Ensemble et le XIXème arrondissement de Paris.
ENSAPLV, Master 2, 2022
Enseignants: Bendicht Weber + Valentina Moimas
Site: Cité Villette, Aubervilliers
Durée: 1 an
Cet ensemble regroupe 1 200 logements pour environ 3 000 habitants. Les logements sont répartis dans vingt tours ayant entre six et dix-huit étages et une barre de quatre étages. Les bâtiments sont groupés autour de deux dalles: La dalle Villette regroupant douze tours et la dalle Félix-Faure en comptant neuf. La cité Villette est gérée par l’OPH d’Aubervilliers, chargé de la gestion du logement social dans la ville.
Depuis son inauguration en 1974, la cité Villette n’a pas encore été rénovée et présente des traces d’usures et de vieillissement importants.
Depuis 2014, un projet de réaménagement de la cité est en train d’être discuté entre la mairie d’Aubervilliers et l’ANRU. Ces deux acteurs mettent en avant le caractère participatif de ce programme.
Pourtant, d’après nos recherches, en 7 ans, une seule journée a été consacrée à recueillir les attentes des habitants et usagers du quartier. Depuis, aucunes informations sur le devenir de la cité ne sont diffusées.
Première cartographie participative réalisé lors d'ateliers sur site avec les habitant.e.s regroupant et spatialisant toutes les notions évoquées.
Cette carte servira de base pour l'élaboration des ateliers thématiques suivants.
Le contexte urbain et social particulier de la cité Villette nous a semblé accentuer la nécessité de proposer un projet d’urbanisme sensé, pensé avec les habitants et usagers du site.
Dans ce but nous avons mis en place des espaces physiques, «matériels», des lieux nous permettant de nous retrouver pour réfléchir ensemble à l’urbain et à l’espace. Ils pouvaient prendre des formes multiples: un local associatif, un pied d’immeuble où nous installions une tables et quelques chaises ou encore l’école lors de nos présentations... Nous permettant ainsi de concevoir ensemble un autre espace: celui de la dalle et changeant ainsi son statue d’espace de passage en espace d’usage.
Mais nous avons très vite souhaité questionner également une autre forme spatiale, que nous avons qualifié d’«immatériels»: ce sont ces temps d’échanges, ces discussions, cet apprentissage réciproque entre connaissance technique et maitrise d’usage. Ces espaces éphémères et impalpables font pourtant partie intégrante de notre travail et nous n’avons eu de cesse que de chercher à les transmettre et à les partager afin que cette richesse ne disparaisse pas.
Pour cela nous avons organisé une série d’ateliers à destination des habitants.
L’ambition de ces ateliers est de créer un espace d’organisation pour les habitants et leurs soutiens afin d’élaborer un projet d’urbanisme participatif qui défende leurs intérêts en vu de la publication du NPNRU.
Le travail a également consisté en une étude fine des usages de la dalle afin de partir de cette réalité spatiale pour proposer un aménagement spécifique.
Le sol vivant: Les objectifs du projet
Proposition d'aménagement final: d'un rez-de-chaussée à un rez-de-chaussée-urbain